Vidéos : Les grands témoins du Centre Alain-Savary
Par skus
—
publié
18/09/2015 16:15,
Dernière modification
15/09/2025 10:57
Une collection de vidéos, qui s'enrichit au fil du temps, de chercheurs et de praticiens dont les discours nous semblent pouvoir aider chacun à penser autour des difficultés des élèves, des enseignants et des pilotes dans l'Ecole. Avec nos partis-pris, mais avec l'ambition de ne pas craindre la controverse, du moment qu'elle soit étayée...





 Dans un entretien de dix-sept minutes, Anne Armand, Inspectrice générale co-auteure du rapport paru en juin 2013 Agir contre le décrochage scolaire : Alliance éducative et approche pédagogique repensée, montre la complexité des contextes dans lesquels la bascule vers le décrochage s'opère et propose des leviers d'action pour le prévenir.
Dans un entretien de dix-sept minutes, Anne Armand, Inspectrice générale co-auteure du rapport paru en juin 2013 Agir contre le décrochage scolaire : Alliance éducative et approche pédagogique repensée, montre la complexité des contextes dans lesquels la bascule vers le décrochage s'opère et propose des leviers d'action pour le prévenir.  "Si on veut travailler efficacement sur la thématique du décrochage scolaire, du début de la maternelle jusqu'au lycée, il faut commencer par dénaturaliser cette question". Jacques BERNARDIN, dans cet entretien, montre comment le fait de regarder la difficulté scolaire non pas comme le propre de certains élèves mais comme le propre des situations pédagogiques et didactiques proposées, redonne aux enseignants, aux formateurs et aux pilotes du pouvoir d'agir en revisitant les pratiques ordinaires de la classe.
"Si on veut travailler efficacement sur la thématique du décrochage scolaire, du début de la maternelle jusqu'au lycée, il faut commencer par dénaturaliser cette question". Jacques BERNARDIN, dans cet entretien, montre comment le fait de regarder la difficulté scolaire non pas comme le propre de certains élèves mais comme le propre des situations pédagogiques et didactiques proposées, redonne aux enseignants, aux formateurs et aux pilotes du pouvoir d'agir en revisitant les pratiques ordinaires de la classe.  Lors de son intervention à l'Institut Français de l'Education, Marie-France Bishop, professeure des universités en sciences de l'Education, spécialiste de didactique du français, à l'université de Cergy Pontoise s’est exprimée sur les résultats de la recherche Lire et Ecrire en ce qui concerne la compréhension en lecture. Marie-France Bishop décline les résultats de la recherche selon trois points de vue, celui des élèves, celui des enseignants et celui des formateurs : - Qu’est-ce que la recherche a observé des difficultés des élèves en compréhension de lecture ? - Qu'est-ce que la recherche a montré de ce que les enseignants enseignent de la compréhension ? - Quelle formation mettre en place pour que la compréhension soit enseignée à tous les élèves de façon efficace ?
Lors de son intervention à l'Institut Français de l'Education, Marie-France Bishop, professeure des universités en sciences de l'Education, spécialiste de didactique du français, à l'université de Cergy Pontoise s’est exprimée sur les résultats de la recherche Lire et Ecrire en ce qui concerne la compréhension en lecture. Marie-France Bishop décline les résultats de la recherche selon trois points de vue, celui des élèves, celui des enseignants et celui des formateurs : - Qu’est-ce que la recherche a observé des difficultés des élèves en compréhension de lecture ? - Qu'est-ce que la recherche a montré de ce que les enseignants enseignent de la compréhension ? - Quelle formation mettre en place pour que la compréhension soit enseignée à tous les élèves de façon efficace ?  La scolarisation en classe ordinaire d'élèves présentant des difficultés comportementales est l'affaire du collectif de l'école. Baptiste Caroff, aujourd'hui IEN, s'appuie sur son expérience de formateur dans l'enseignement spécialisé pour montrer comment les besoins qui relèvent de la nécessité pour certains élèves, conduisent les équipes, lorsqu'elles sont accompagnées, à développer des pratiques pédagogiques qui sont utiles à tous les élèves.
La scolarisation en classe ordinaire d'élèves présentant des difficultés comportementales est l'affaire du collectif de l'école. Baptiste Caroff, aujourd'hui IEN, s'appuie sur son expérience de formateur dans l'enseignement spécialisé pour montrer comment les besoins qui relèvent de la nécessité pour certains élèves, conduisent les équipes, lorsqu'elles sont accompagnées, à développer des pratiques pédagogiques qui sont utiles à tous les élèves. Pour Sylvie Cèbe, Isabelle Roux-Baron, proposer aux enseignants des outils conçus avec des pairs peut être une manière efficace de les former, sans attendre d'eux qu'ils aient le temps de concevoir eux-mêmes des outils.
Pour Sylvie Cèbe, Isabelle Roux-Baron, proposer aux enseignants des outils conçus avec des pairs peut être une manière efficace de les former, sans attendre d'eux qu'ils aient le temps de concevoir eux-mêmes des outils. A partir des travaux de Vygotski sur l'art, Anne Clerc Georgy, chercheure-formatrice à la Haute école de pédagogie (HEP) de Vaud en Suisse, nous fait part de son travail scientifique sur le développement et la construction de l'imagination chez l'enfant et l'adolescent.
A partir des travaux de Vygotski sur l'art, Anne Clerc Georgy, chercheure-formatrice à la Haute école de pédagogie (HEP) de Vaud en Suisse, nous fait part de son travail scientifique sur le développement et la construction de l'imagination chez l'enfant et l'adolescent. Quels sont les savoirs sur l'enseignement du lire-écrire au cycle 2qui font consensus ? Où sont les discussions ? Peut-on proposer des pistes utilisables pour les enseignants ? Roland Goigoux fait le point à partir des fruits de la recherche Lire-Ecrire qu'il a dirigée, en pointant ce qui lui semble converger (ou pas...) avec d'autres résultats de recherches.
Quels sont les savoirs sur l'enseignement du lire-écrire au cycle 2qui font consensus ? Où sont les discussions ? Peut-on proposer des pistes utilisables pour les enseignants ? Roland Goigoux fait le point à partir des fruits de la recherche Lire-Ecrire qu'il a dirigée, en pointant ce qui lui semble converger (ou pas...) avec d'autres résultats de recherches. "Écrire c'est à la fois calligraphier, copier, encoder et produire" explique Bernadette Kervyn, maitre de conférence à l'université de Bordeaux lors de son intervention en formation de formateurs à l'IFÉ en novembre 2017. Partie prenante de la recherche Lire et Ecrire, elle s'intéresse particulièrement à l'écriture : encodage, copie différée et production d'écrits.
"Écrire c'est à la fois calligraphier, copier, encoder et produire" explique Bernadette Kervyn, maitre de conférence à l'université de Bordeaux lors de son intervention en formation de formateurs à l'IFÉ en novembre 2017. Partie prenante de la recherche Lire et Ecrire, elle s'intéresse particulièrement à l'écriture : encodage, copie différée et production d'écrits. "Il vaut mieux soutenir l'existant que de prescrire l'idéal". Au-delà de la prescription du "travail collectif", comment soutenir et aménager les conditions de celui-ci ? Intervention à la formation "Le travail collectif en REP+" en octobre 2014.
"Il vaut mieux soutenir l'existant que de prescrire l'idéal". Au-delà de la prescription du "travail collectif", comment soutenir et aménager les conditions de celui-ci ? Intervention à la formation "Le travail collectif en REP+" en octobre 2014.  Julien Netter est doctorant au laboratoire ESCOL de l’université Paris 8. Il présente les résultats de recherches qui portent sur tous les éléments qui circulent entre l’école, les familles et le périscolaire pour observer et analyser ce qui se joue sur le plan des apprentissages et des socialisations scolaires.
Julien Netter est doctorant au laboratoire ESCOL de l’université Paris 8. Il présente les résultats de recherches qui portent sur tous les éléments qui circulent entre l’école, les familles et le périscolaire pour observer et analyser ce qui se joue sur le plan des apprentissages et des socialisations scolaires. Conférence chapitrée de Pierre Périer (janv. 2014) sociologue et enseignant chercheur à l'université de Rennes. Il nous invite à penser globalement la relation École-Famille dans l'intérêt des enfants et des jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires ou qui posent des difficultés à l'institution
Conférence chapitrée de Pierre Périer (janv. 2014) sociologue et enseignant chercheur à l'université de Rennes. Il nous invite à penser globalement la relation École-Famille dans l'intérêt des enfants et des jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires ou qui posent des difficultés à l'institution Le centre Alain-Savary a identifié cinq dimensions pour aider les formateurs à concevoir des actions de formation continue. Patrick Picard, responsable du centre, explique la démarche qui accompagne ces repères pour la conception de formation : une aide à la vigilance plutôt qu'une martingale.
Le centre Alain-Savary a identifié cinq dimensions pour aider les formateurs à concevoir des actions de formation continue. Patrick Picard, responsable du centre, explique la démarche qui accompagne ces repères pour la conception de formation : une aide à la vigilance plutôt qu'une martingale. En quoi les propos d’un sociologue de l’action publique peuvent-ils rejoindre les préoccupations des formateurs et des pilotes ? Xavier Pons s’intéresse à la façon dont les politiques conçoivent et mettent en oeuvre des réformes, et donc cherche à comprendre les relations entre les acteurs. En plongeant dans les vingt dernières années de politiques éducatives, il nous livre des clés tout à fait utiles pour comprendre et agir au présent.
En quoi les propos d’un sociologue de l’action publique peuvent-ils rejoindre les préoccupations des formateurs et des pilotes ? Xavier Pons s’intéresse à la façon dont les politiques conçoivent et mettent en oeuvre des réformes, et donc cherche à comprendre les relations entre les acteurs. En plongeant dans les vingt dernières années de politiques éducatives, il nous livre des clés tout à fait utiles pour comprendre et agir au présent. Pour Patrick Rayou, nombre d'élèves de l'EP élèves jugent l’école par le prisme de la justice, et peuvent avoir le sentiment d'être victime d’inégalités. Il précise le concept de "malentendu socio-cognitif" avancé par ESCOL et Paris 8, notamment lorsqu'enseignants, élèves et parents comprennent différemment le sens des tâches et obligations liées à la norme scolaire, nécessairement différentes de celles de la maison. « S’il existe l’Ecole c’est parce que la vie n’en n’est pas une » reprend-t-il en précisant que l’école prépare à la « vraie vie » sans être la « vraie vie ».
Pour Patrick Rayou, nombre d'élèves de l'EP élèves jugent l’école par le prisme de la justice, et peuvent avoir le sentiment d'être victime d’inégalités. Il précise le concept de "malentendu socio-cognitif" avancé par ESCOL et Paris 8, notamment lorsqu'enseignants, élèves et parents comprennent différemment le sens des tâches et obligations liées à la norme scolaire, nécessairement différentes de celles de la maison. « S’il existe l’Ecole c’est parce que la vie n’en n’est pas une » reprend-t-il en précisant que l’école prépare à la « vraie vie » sans être la « vraie vie ». Yves Reuter est didacticien du français et avec le laboratoire Théodile, de l'Université de Lille, dont il est le directeur, il a mené une recherche sur le vécu disciplinaire des élèves comme élément de compréhension du décrochage scolaire.
Yves Reuter est didacticien du français et avec le laboratoire Théodile, de l'Université de Lille, dont il est le directeur, il a mené une recherche sur le vécu disciplinaire des élèves comme élément de compréhension du décrochage scolaire. Responsable du service "Veille & Analyses" de l'IFÉ, Olivier Rey précise à quelles conditions il lui semble possible de réformer le système éducatif. Il s'appuie sur le dossier qu'il a réalisé, pour rendre accessibles les résultats des recherches internationales sur la question.
Responsable du service "Veille & Analyses" de l'IFÉ, Olivier Rey précise à quelles conditions il lui semble possible de réformer le système éducatif. Il s'appuie sur le dossier qu'il a réalisé, pour rendre accessibles les résultats des recherches internationales sur la question. Dans la filiation d'Henri Wallon et de Lev Vygotski, Jean-Yves Rochex, professeur en Sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 Saint-Denis, définit le rôle de l'école dans le développement de l'enfant, ainsi que des concepts utiles à l'enseignement et à la formation des enseignants : expliciter, triple autorisation, norme et normativité, zone proximale de développement (ZPD), etc.
Dans la filiation d'Henri Wallon et de Lev Vygotski, Jean-Yves Rochex, professeur en Sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 Saint-Denis, définit le rôle de l'école dans le développement de l'enfant, ainsi que des concepts utiles à l'enseignement et à la formation des enseignants : expliciter, triple autorisation, norme et normativité, zone proximale de développement (ZPD), etc. «Ce qui se joue de plus intéressant dans le développement langagier c’est ce qui se fait en dehors des activités pointées « langage » dans le continuum des domaines d’apprentissage ». Entre langage ordinaire, langage scolaire et langages disciplinaires, Yves Soulé, formateur à l’ESPÉ de Montpellier en didactique du langage, déplie les difficultés que l’enseignement de l’oral représente et propose des pistes de formation pour les formateurs.
«Ce qui se joue de plus intéressant dans le développement langagier c’est ce qui se fait en dehors des activités pointées « langage » dans le continuum des domaines d’apprentissage ». Entre langage ordinaire, langage scolaire et langages disciplinaires, Yves Soulé, formateur à l’ESPÉ de Montpellier en didactique du langage, déplie les difficultés que l’enseignement de l’oral représente et propose des pistes de formation pour les formateurs.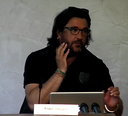 Concevoir des situations d'apprentissages, c'est penser l'engagement des élèves dans la tâche, la faisabilité de la tâche, les enjeux d'apprentissage dans la tâche et leur appropriabilité. André Tricot, psychologue cognitiviste, propose une approche en 4 niveaux pour aider les professionnels à concevoir des situations d'apprentissage.
Concevoir des situations d'apprentissages, c'est penser l'engagement des élèves dans la tâche, la faisabilité de la tâche, les enjeux d'apprentissage dans la tâche et leur appropriabilité. André Tricot, psychologue cognitiviste, propose une approche en 4 niveaux pour aider les professionnels à concevoir des situations d'apprentissage. Conférence de Sylvie Plane, professeure émérite de Sciences du langage : l’oral, objet de passions et de malentendus ; les enjeux et statuts de l’oral dans la classe ; les multiples dimensions de l’oral ; quelques pistes de travail pour les enseignants.
Conférence de Sylvie Plane, professeure émérite de Sciences du langage : l’oral, objet de passions et de malentendus ; les enjeux et statuts de l’oral dans la classe ; les multiples dimensions de l’oral ; quelques pistes de travail pour les enseignants.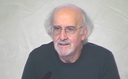 Rémi Brissiaud, chercheur et pédagogue français, maître de conférences de psychologie, spécialisé dans l’étude de l’acquisition et du développement des compétences arithmétiques chez l’enfant. Dans cette conférence, Rémi Brissiaud réaffirme l'importance d'enseigner le comptage-dénombrement pour permettre aux élèves de construire le concept de nombre.
Rémi Brissiaud, chercheur et pédagogue français, maître de conférences de psychologie, spécialisé dans l’étude de l’acquisition et du développement des compétences arithmétiques chez l’enfant. Dans cette conférence, Rémi Brissiaud réaffirme l'importance d'enseigner le comptage-dénombrement pour permettre aux élèves de construire le concept de nombre. Emmanuel Sander, Université de Genève, montre comment tout individu s’appuie sur des connaissances de la vie quotidienne, les analogies intuitives, pour construire ses représentations mathématiques des problèmes arithmétiques. Suivant les situations, elles jouent un rôle facilitateur ou obstructif pour la résolution.
Emmanuel Sander, Université de Genève, montre comment tout individu s’appuie sur des connaissances de la vie quotidienne, les analogies intuitives, pour construire ses représentations mathématiques des problèmes arithmétiques. Suivant les situations, elles jouent un rôle facilitateur ou obstructif pour la résolution.  Conférences de Joël Briand, maitre de conférence honoraire en mathématiques "Place et rôle de la manipulation dans la construction du nombre et la résolution de problème aux cycles 1, 2 et 3" ainsi que "L'enseignement des nombres décimaux à l'école primaire et au collège"
Conférences de Joël Briand, maitre de conférence honoraire en mathématiques "Place et rôle de la manipulation dans la construction du nombre et la résolution de problème aux cycles 1, 2 et 3" ainsi que "L'enseignement des nombres décimaux à l'école primaire et au collège"  Dominique Lahanier Reuter, didacticienne des mathématiques et chercheuse au laboratoire LACES EA de l'université de Bordeaux, présente ses travaux sur le(s) vécu(s) disciplinaire(s) des élèves et notamment en mathématiques. Elle met en avant la prise en compte des émotions et des sentiments comme levier dans l'enseignement des mathématiques.
Dominique Lahanier Reuter, didacticienne des mathématiques et chercheuse au laboratoire LACES EA de l'université de Bordeaux, présente ses travaux sur le(s) vécu(s) disciplinaire(s) des élèves et notamment en mathématiques. Elle met en avant la prise en compte des émotions et des sentiments comme levier dans l'enseignement des mathématiques. Organiser la controverse dans les organisations de travail, dans les espaces de formation consiste à organiser le dialogue entre les acteurs concernés autour de situations de travail pour faire face à leur complexité. En quoi la controverse sur le travail peut-être une ressource pour les professionnels ?
Organiser la controverse dans les organisations de travail, dans les espaces de formation consiste à organiser le dialogue entre les acteurs concernés autour de situations de travail pour faire face à leur complexité. En quoi la controverse sur le travail peut-être une ressource pour les professionnels ? Anne Gombert, maitresse de conférence en psychologie cognitive et éducation, développe la question de l'accessibilité au sein de la classe autour du concept de la conception universelle des apprentissages.
Anne Gombert, maitresse de conférence en psychologie cognitive et éducation, développe la question de l'accessibilité au sein de la classe autour du concept de la conception universelle des apprentissages. Luc Ria, professeur des universités en Sciences de l'Education et de la Formation à l'ENS de Lyon, intervient sur les fondements, les outils et les usages de l'analyse du travail dans l'accompagnement des enseignants
Luc Ria, professeur des universités en Sciences de l'Education et de la Formation à l'ENS de Lyon, intervient sur les fondements, les outils et les usages de l'analyse du travail dans l'accompagnement des enseignants Maïtena Armagnague retrace l'évolution historique des politiques éducatives envers les élèves primo-migrants dit allophones. Elle met au jour la centralité linguistique dans la scolarisation de ces élèves et les enjeux sociologiques liés à l'usage du plurilinguisme en classe, qui peut à la fois favoriser la communication et la prise en compte de la diversité, mais aussi soulever des malentendus et des assignations identitaires.
Maïtena Armagnague retrace l'évolution historique des politiques éducatives envers les élèves primo-migrants dit allophones. Elle met au jour la centralité linguistique dans la scolarisation de ces élèves et les enjeux sociologiques liés à l'usage du plurilinguisme en classe, qui peut à la fois favoriser la communication et la prise en compte de la diversité, mais aussi soulever des malentendus et des assignations identitaires. En quoi les usages de la langue en mathématiques sont une source de complexité et de difficulté pour les élèves ? Quels sont les leviers possibles pour l'enseignement et l'apprentissage ? Christophe Hache est chercheur en didactique des mathématiques au LDAR de l'université Paris Cité. Il porte son regard sur ces questions.
En quoi les usages de la langue en mathématiques sont une source de complexité et de difficulté pour les élèves ? Quels sont les leviers possibles pour l'enseignement et l'apprentissage ? Christophe Hache est chercheur en didactique des mathématiques au LDAR de l'université Paris Cité. Il porte son regard sur ces questions.